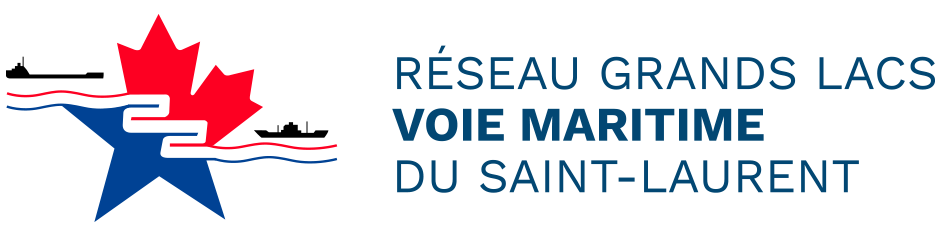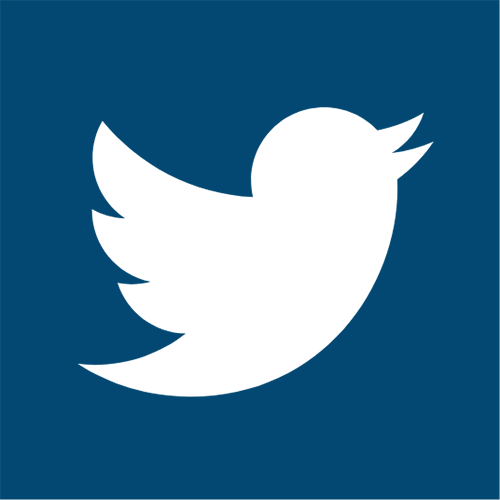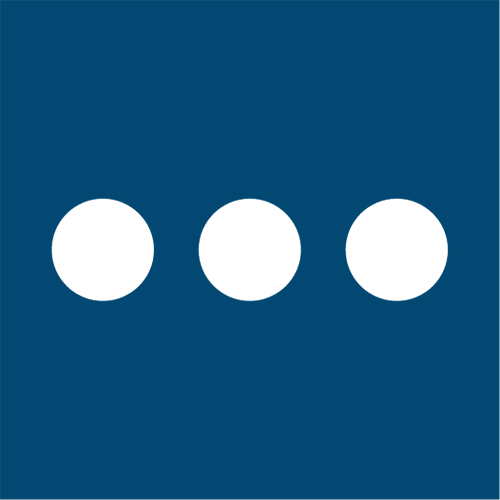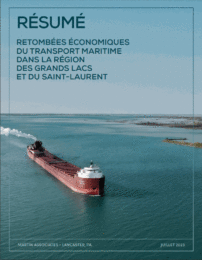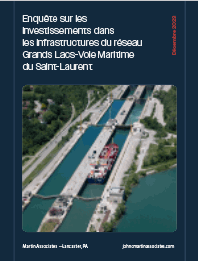Retombées économiques
Les retombées économiques du transport maritime dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Les retombées économiques du transport maritime dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Le transport de marchandises sur la voie navigable Grands Lacs-Voie maritime engendre 50 milliards USD d’activité économique et 356,858 emplois au Canada et aux États-Unis.
Au début de la colonisation, on circulait déjà sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. Des postes de traite ont été établis le long de la vaste voie maritime à proximité des Grands Lacs, voie qui a facilité le commerce à une époque où il n’y avait ni routes ni chemins de fer. C’est ce lien avec l’eau qui a permis à la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent de se développer, région qui aujourd’hui est le centre industriel et agricole des États-Unis et du Canada – avec un PIB combiné qui dépasse les 6 trillions de dollars US. S’il s’agissait d’un pays, cette production représenterait la troisième économie en importance au monde – derrière les États-Unis et la Chine.
Ces deux derniers siècles, tant les États-Unis que le Canada ont profité des avancées en navigation dans la région. C’est en 1829 que fut inauguré le canal Welland, reliant les lacs Ontario et Érié et permettant, à l’aide d’un système d’écluses, de contourner les chutes Niagara. Les écluses du Sault ont quant à elles rendu navigable la rivière Ste-Marie, qui relie le lac Supérieur aux quatre Grands Lacs inférieurs et à la Voie maritime du Saint-Laurent. C’est d’ailleurs grâce à cette voie que les navires peuvent entreprendre la traversée de l’océan Atlantique à partir du lac Ontario depuis 1959.
Les 3 700 km (2 300mi) de ce réseau de navigation intérieure pour les navires à fort tirant d’eau au cœur de l’Amérique du Nord en font le plus long au monde. S’ajoutant aux réseaux ferroviaire et routier, ce couloir commercial binational propose aux clients une solution économique, sûre, fiable et verte pour transporter matières premières, produits agricoles et produits fabriqués entre les marchés nationaux et mondiaux. Sont notamment transportés du minerai de fer, du charbon, de l’acier, de l’aluminium, de la machinerie, de la pierre, du ciment, des céréales, du sucre, de l’engrais, du sel de déglaçage, des produits pétroliers et des cargaisons conteneurisées. Bref, de quoi produire les essentiels du quotidien : de la nourriture et des articles de maison; des bâtiments, des usines, des routes et des ponts; des véhicules et des avions; et l’énergie pour alimenter nos villes et villages.
Trois groupes d’exploitants de navires circulent sur la Voie: des transporteurs intérieurs américains (les « laquiers » américains), qui desservent les ports des Grands Lacs; des transporteurs intérieurs canadiens (les « laquiers » canadiens), qui naviguent entre les ports des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et dans les eaux côtières du Canada; et des navires océaniques (les « océaniques »), qui circulent entre les ports de la région et outre-mer. Ces transporteurs servent plus de 110 ports du réseau situés dans les huit États des Grands Lacs de même que les provinces de l’Ontario et du Québec.
Outre le personnel des écluses, des navires et des ports, de nombreux fournisseurs de services maritimes veillent à la sûreté, à la fiabilité et à l’efficacité du transport de marchandises, notamment: arrimeurs, personnel d’entrepôt, transitaires, débardeurs, opérateurs de grues, agents maritimes, entrepreneurs de dragage, pilotes maritimes, chauffeurs de camion et cheminots du port, opérateurs de remorqueur et travailleurs de chantier naval.
Sondage sur les investissements dans les infrastructures du réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent
11 milliards de dollars pour le transport maritime sur les Grands Lacs et le Saint-Laurent
La dernière enquête d’investissement, compilée par les consultants en commerce maritime de Martin Associates, totalise un montant substantiel de 10,9 milliards de dollars canadiens en dépenses en capital pour les navires, les ports et terminaux, ainsi que les l’infrastructures des voies navigables dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
De 2018 à 2022, plus de 7,4 milliards de dollars ont été investis dans le système de navigation, et 3,5 milliards de dollars supplémentaires sont engagés pour des améliorations de 2023 à 2027.
Les gouvernements fédéraux canadien et américain ont conjointement investi environ 4 milliards de dollars pour moderniser l’infrastructure et la technologie de la Voie maritime. Cette initiative est mise en œuvre par : la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent au Canada et la Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation aux États-Unis. Cet investissement substantiel s’étale sur une période de 24 ans, marquant la transformation la plus significative de la Voie maritime au cours des cinq dernières décennies. Les ports et terminaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent investissent aussi collectivement plus de 2,7 milliards de dollars dans l’agrandissement de leurs quais, dans l’amélioration de leur équipement, dans la modernisation de leurs installations et dans le renforcement de leurs connexions intermodales.
Le contenu provenant d’un organisme qui n’est pas assujetti à la Loi sur les langues officielles est fourni au public dans la langue d’origine.